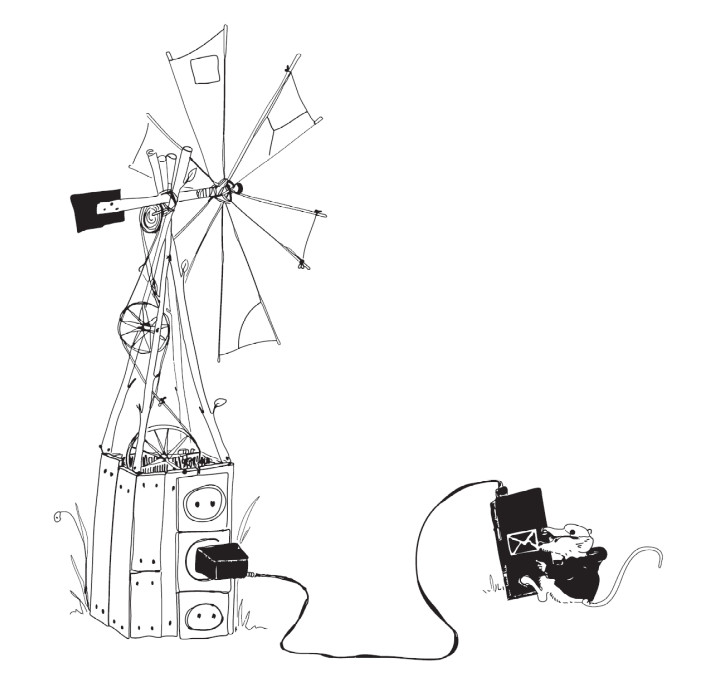Préface à l’édition française
L’espace public contre la rue
Cela fait longtemps que les architectes et les urbanistes ont pour fonction d’éviter que la vie urbaine ne soit la vie tout court. D’où leur obsession de soumettre, grâce au pouvoir magique qu’ils attribuent aux plans et aux projets, la fièvre des rues, les diverses formes de désobéissance et de désertion qu’elles abritent, leur univers dans lequel tout est toujours sur le point de se passer, et parfois se passe. Un nouveau genre d’ « experts » est récemment venu contribuer aux dispositifs sans âme déployés par les technocrates contre l’agitation chronique des espaces extérieurs urbains : « penseurs urbains », philosophes, chercheurs en sciences sociales, politologues…, tous avides, eux aussi, d’apporter leur pierre à la caractérisation, à la classification et à la qualification d’un territoire donné, non seulement sur un plan formel, mais aussi moral et même juridique.
Il s’est agi dès lors de conférer une plus-value symbolique, une valeur en quelque sorte supérieure aux espaces urbains au sens d’espace de et pour ce que Henri Lefebvre avait nommé l’urbain, en sauvant ces espaces de leur opacité, en les délivrant de ce qu’ils avaient toujours eu de paradoxal, de contradictoire, de fragmentaire… L’objectif : transformer ce qui existe – l’enchevêtrement autonome d’événements que constitue la sociabilité urbaine – en ce qui devrait exister. Il s’agit de matérialiser dans l’espace des idéaux officiels en ce qui concerne la ville, à savoir les valeurs abstraites de l’urbanité comme manière correcte d’occuper et d’employer la ville ; autrement dit, de passer de citadin à civilisé.
Ceci explique la mise en circulation d’un concept d’espace public, qui, emprunté à la philosophie politique, demande à être interprété non comme théâtre vivant du social en tant que processus et travail sans fin, mais comme cadre d’une chimère : le rêve impossible d’une classe moyenne universelle et sûre d’elle-même, aspirant à vivre dans un monde fait de consensus négociés et d’échanges communicationnels purs entre des êtres éclairés, en accord et responsables, un monde sans convulsions ni incidents, dans lequel on pourrait faire comme si l’injustice et l’inégalité, devenues d’un coup invisibles, n’existaient pas. Ce qui constituait jusqu’il y a peu des lieux publics – public places –, des scènes actives de la vie commune entre inconnus, non harmonisée de force, s’est fait imposer un concept d’espace public – public space –, qui désigne bien plus qu’un simple territoire accessible à tous, étant donné qu’on le charge de la réalisation dans l’espace des principes éthiques supposés régir une société d’êtres libres et égaux, ce qui est un leurre.
Pour que cet espace idéal devienne réel, il est indispensable que tout ce qui peut en dénoncer l’imposture – la misère, la désobéissance, la tristesse, la simple laideur – soit banni, caché ou tenu à distance. D’où cette batterie de législations et de normes présentées comme « civiques », permettant à la police et aux juges d’achever la tâche stérilisante à laquelle les architectes et les urbanistes ont voué leurs programmes, les administrateurs leurs règlements et les théoriciens de la virtuosité civique leurs rhétoriques. Ils ne supportent pas que les espaces réels de la vie urbaine puissent recouvrir et mêler tant de choses, et ils redoutent par-dessus tout le conflit, toujours susceptible de mettre à bas leurs illusions d’embellissement et de contrôle. Dans l’espace public imaginaire des appropriations appropriées et de la civilité bien intégrée, le conflit est inconcevable, étant donné qu’il dément l’illusion d’un terrain neutre qui aurait suspendu toute lutte et toute dissidence, au nom d’une trêve entre les secteurs sociaux divisés par des intérêts et des identités incompatibles qu’il faudrait renier eu égard à la réconciliation des antagonistes requise par le vivre-ensemble citoyen.
Le résultat de l’alliance entre les techniciens du design urbain et les chantres de la doctrine citoyenniste est ce qu’on présente pompeusement comme des « espaces publics de qualité ». Ces derniers ne font que fournir un nouveau moyen d’expression et d’action à l’antique haine des foules propre au pouvoir, à l’obstination de celui-ci à dompter l’urbain comme s’il s’agissait d’une machine déréglée et imprévisible, toujours susceptible de convulsions, jamais totalement gouvernable. Dans une période comme la nôtre, qui oblige non seulement à soumettre les villes, mais aussi à les mettre en vente, il est bien connu qu’une ville ne peut être compétitive sur le marché que si elle s’est pacifiée au préalable et a montré sa disposition à renoncer à ce qui la trouble, c’est-à-dire à ce qui la nourrit et la maintient en vie. Ce n’est pas un hasard si la notion d’espace public s’est imposée dans les dernières décennies comme moyen de neutraliser l’urbain, prérequis fondamental pour la transformation de la physionomie aussi bien humaine que morphologique d’un grand nombre de villes, transformation qui consiste de plus en plus en une revitalisation en espaces marchands de quartiers du centre ou de la périphérie autrefois populaires, ou d’anciennes zones industrielles ou portuaires désormais abandonnées, et requalifiées soit comme résidentielles « haut de gamme », soit comme sites d’implantation des nouvelles industries technologiques et des pôles de recherche.
Mais cet horizon d’apaisement des villes est encore loin d’être atteint par ceux qui croient les gouverner et les organiser ; ils ne sont jamais parvenus à comprendre de quoi elles sont faites et ce qui les rend vivantes. Il est certain que c’est pour dissuader toute indiscipline et pour calmer les troubles qu’a été mis en place ce nouvel artefact taxinomique qu’est l’ « espace public », dont les intellectuels créateurs de modèles de ville saluent l’idéologie et au service duquel, afin de le concrétiser physiquement, les designers urbains conçoivent des formes, imposent des hiérarchies, attribuent des significations, déterminent ou croient déterminer des usages. Mais pendant ce temps-là, dans l’indifférence aux théories et aux planifications, à ras du sol, là-dehors, rien ne peut empêcher que continuent à se multiplier les va-et-vient et les entrecroisements sans fin des corps et des regards, le maraudage des multitudes, la menace de l’imprévu, tout ce que, jusqu’à il y a peu encore, nous courions le risque d’appeler tout simplement la rue.
Manuel Delgado, avril 2016, Barcelone.
Introduction
De quoi parle-t-on aujourd’hui lorsqu’on parle d’espace public ? Pour les urbanistes, les architectes et les designers, l’espace public renvoie au vide à remplir entre des bâtiments en répondant aux objectifs des promoteurs et à ceux des autorités – qui sont souvent les mêmes, bien évidemment. Il s’agit dans ce cas d’une zone à aménager et réaménager, d’un environnement à organiser pour assurer la bonne fluidité de circulation et conserver les usages et les significations prescrites, un espace aseptisé qui devra garantir sécurité et stabilité aux bureaux d’affaires et aux bâtiments officiels environnants. Ce n’est pas un hasard si la notion d’espace public est devenue à la mode chez les planificateurs, notamment au moment des grandes initiatives de reconversion urbaine ; elle permet de rendre celles-ci alléchantes pour la spéculation, le tourisme et les exigences de légitimité des institutions. Parler alors d’espace, dans un cadre déterminé par l’aménagement capitaliste du territoire et la production immobilière, s’avère toujours un euphémisme : ce qu’en réalité on veut désigner par ce mot, c’est le terrain.
Conjointement à cette idée de l’espace public comme complément rassurant des opérations urbanistiques, un autre discours se répand, basé sur le même concept, mais avec un éventail de significations plus large et une volonté plus ambitieuse encore d’influer sur les comportements et les idées. L’espace public en vient ici à être perçu comme la réalisation d’une valeur idéologique, un lieu dans lequel se matérialisent diverses catégories abstraites telles que la démocratie, la citoyenneté, le vivre ensemble, le civisme, le consensus et autres valeurs politiques aujourd’hui centrales. Il devient une avant-scène sur laquelle on aimerait que se déploie une masse ordonnée d’êtres libres et égaux utilisant cet espace pour aller travailler ou consommer et circulant, pendant leurs moments de loisir, en toute tranquillité au milieu d’une oasis de courtoisie. Il va sans dire qu’il convient d’expulser ou de refuser l’accès à ce territoire à quiconque s’avère incapable d’employer les manières de la classe moyenne à l’usage de laquelle il est réservé.
Ce qu’il faudrait bien reconnaître comme l’idéalisme de l’espace public est mis au service de la réappropriation capitaliste de la ville. Cette dynamique repose structurellement sur la transformation de grands secteurs de l’espace urbain en parcs à thème, la gentrification de centres historiques desquels l’histoire a été définitivement bannie, la reconversion de quartiers industriels entiers, la dispersion d’une misère croissante qu’on ne parvient plus à cacher, le contrôle d’un espace public de moins en moins public, etc. Ce processus se déroule en parallèle d’une démission des agents publics de leur devoir de garantie des droits démocratiques fondamentaux – profiter de la rue en toute liberté, accéder à un logement digne… – et du démantèlement des restes de ce qui fut prétendument, un jour, l’État providence. De façon apparemment paradoxale, l’abandon par les institutions politiques de leurs supposées priorités en matière de bien commun se révèle tout à fait compatible avec un autoritarisme notable dans d’autres milieux. Ainsi, ces mêmes instances politiques, qui paraissent soumises ou s’effacent devant le libéralisme urbanistique et ses abus, peuvent-elles se montrer obsédées par le contrôle de certaines rues et places – désormais contraintes de se transformer en « espaces publics de qualité » –, conçues comme de purs et simples accessoires des grandes opérations immobilières.
Seulement voilà, ce rêve d’un espace public entièrement fait de dialogue et de concorde, où prolifère une armada de volontaires avides de collaborer, s’effondre dès qu’apparaissent les signes extérieurs d’une société dont la matière première est l’inégalité et l’échec. Au lieu de l’aimable paradis de civilité et de civisme que devrait représenter toute ville, telles qu’elles ont été planifiées, ce qui saute aux yeux de tous demeure la preuve que l’abus, l’exclusion et la violence sont les ingrédients consubstantiels à l’existence d’une ville capitaliste. Partout, les signes de cette désillusion se font jour : le désir de transformer les villes en une représentation du triomphe final d’une utopie civile se fissure sous le poids de tous les désastres sociaux que celle-ci induit.
Ce livre contient une série de considérations sur ces questions. Il s’agit avant tout d’un essai dans lequel on trouve une genèse et une analyse du rôle dogmatique du concept actuellement en vigueur d’espace public. Nous l’avons intitulé L’Espace public comme idéologie ; il résume une critique de ce que sont aujourd’hui les rhétoriques légitimantes qui accompagnent la planification urbaine et les discours institutionnels destinés à l’assujettissement moral des habitants des métropoles.
Chapitre 1 – L’espace public, discours et lieu
L’espace public comme discours
La notion d’espace public prend chaque jour plus d’importance dans la gestion des villes, à la fois comme élément inhérent à toute morphologie urbaine et comme but de tout type d’interventions urbanistiques, au double sens d’objet de l’urbanisme et de l’urbanité. Ce concept d’espace public s’est répandu, devenant dans les dernières décennies l’ingrédient fondamental aussi bien des discours politiques relatifs au concept de citoyenneté et à la réalisation des principes égalitaires attribués aux systèmes « démocratiques », que celui d’un urbanisme et d’une architecture qui, nécessairement en lien avec ces présupposés politiques, travaillent de façon tout aussi idéologique – bien que cette dimension ne soit jamais explicitée – à la qualification et à la codification provoquées par les vides urbains précédant ou accompagnant tout environnement construit. Cela est d’autant plus vrai si cet environnement est le produit de réformes ou de la revitalisation de centres urbains ou de zones industrielles dites obsolètes et en cours de reconversion.
À partir de quel moment les rhétoriques politico-urbanistiques ont-elles programmé et appliqué ce concept d’espace public ? Si l’on prend quelques-uns des ouvrages classiques de la pensée urbaine des années 1960 et 1970, voire 1980, la notion d’espace public n’y apparaît quasiment pas, sauf pour étoffer celle de rue, et encore, selon une acception qu’exprimeraient bien d’autres concepts tels que « espace social », « espace commun », « espace partagé », « espace collectif », etc. Regardons par exemple le Déclin et survie grandes villes américaines, livre fondamental de Jane Jacobs. La notion d’espace public n’émerge qu’à une seule occasion[1] – comme synonyme de rue, voire de trottoir. Dans un ouvrage essentiel pour l’étude des conduites piétonnières, Pas à pas, de Jean-François Augoyard[2], on ne rencontre pas non plus le sens d’espace public, même si l’on pourrait penser qu’il s’agit de l’objet de l’ouvrage. Dans les index analytiques de A Theory of Good City Form de Kevin Lynch[3], ou de Human Aspects of Urban Form, d’Amos Rapoport[4], on trouve l’expression « espace public ». Un des théoriciens actuels de l’espace public, Jordi Borja, n’emploie pas ce concept dans son livre Estado y Ciudad, qui réunit ses textes des années 1970 et 1980[5]. Henri Lefebvre[6], pas plus que Raymond Ledrut[7], ne parlent d’espace public. Dans le tout aussi élémentaire City, de William H. Whyte, la locution « espace public » n’apparaît que dans quatre pages[8], ce qui n’est rien comparé aux dizaines de pages qui contiennent « rue » ou « place ». Dans d’autres textes majeurs de la théorie urbaine antérieurs aux années 1990, l’expression « espace public », quand elle est utilisée, sert toujours à désigner de manière globale, et sans insistance particulière, les espaces ouverts et accessibles d’une ville. À ce sens générique pour lequel nous sommes quelques-uns à préférer l’appellation « espace urbain »[9], non pas comme espace « de la ville », mais comme espace-temps spécifique à un type particulier de la réunion humaine, urbaine, dans lequel on remarque un échange généralisé et constant d’informations structuré par la mobilité.
Autrement dit, on pourrait également définir l’espace public comme un espace des et pour les relations en public, c’est-à-dire destiné aux relations entre des individus amenés à se rencontrer physiquement dans des lieux de passage, où ils doivent mener à bien une série d’accommodations et d’arrangements mutuels pour s’adapter à l’association momentanément constituée. Le livre de référence à cet égard est celui d’Erving Goffman, Comment se comporter dans les lieux publics : notes sur l’organisation sociale des comportements[10]. Il convient de rattacher à cet ordre d’idées les travaux de Lyn H. et John Lofland, qui fournissent une définition de l’espace public on ne peut plus claire : « Par espace public j’entends ces endroits d’une ville auxquels, la plupart du temps, tout le monde a accès légalement. J’entends par là les rues de la ville, ses parcs, ses lieux de commodité publics. J’entends aussi les bâtiments publics ou les « zones publiques » des bâtiments privés. Il faut distinguer l’espace public de l’espace privé, dont l’accès peut être objet de restrictions légales[11]. »
En parallèle, on trouve un second type de définitions relatives à l’espace public propres à la philosophie politique. Elles renvoient à un processus spécifique de constitution et d’organisation du lien social. L’espace public s’associe alors à la sphère publique, comme réunion de personnes particulières qui contrôlent l’exercice du pouvoir et donnent leur avis sur des affaires concernant la vie en commun. Le concept d’espace public relève dans ce cas d’une catégorie politique et reçoit deux interprétations, qui trouvent à leur tour chacune leur origine dans un terreau philosophique. Il y a d’un côté celle qui, dans le prolongement de l’opposition entre polis et oikos, impliqua une reconstruction contemporaine de la pensée politique d’Aristote, que l’on doit surtout à Hannah Arendt[12]. De l’autre, une réflexion sur le processus qui conduisit, à partir du XVIIIe siècle, à une restriction croissante et méthodique de la domination politique, impliquant l’institutionnalisation de la censure morale de l’activité des gouvernants, basée sur une structure sociopolitique dont les fondements sont les libertés formelles – ou publiques – et l’égalité devant la loi. Si la première voie peut être présentée comme celle du modèle grec de l’espace public, la deuxième correspond plutôt à celle du modèle bourgeois, dont la genèse a été retracée notamment par Koselleck[13] et Habermas[14], et dont les implications sociologiques ont été dégagées, entre autres, par Richard Sennett[15].
Aucune des acceptions de l’espace public que nous avons mentionnées n’est, telle quelle, celle que nous trouvons en usage de nos jours. L’emploi généralisé de ce concept de la part des designers, des architectes, des urbanistes et des gestionnaires depuis guère plus de trois décennies correspond à une superposition d’interprétations qui jusqu’alors existaient indépendamment les unes des autres : d’une part celle de l’espace public comme ensemble de lieux en libre accès, de l’autre celle de l’espace public comme milieu où se développe une forme spécifique de lien social et de relation avec le pouvoir. Cela veut dire que c’est la topographie chargée ou investie de moralité à laquelle on fait appel, non seulement quand on parle d’espace public dans les discours institutionnels et techniques sur la ville, mais aussi dans toutes sortes de campagnes pédagogiques pour les « bonnes conduites citoyennes » et dans la totalité des règlements municipaux, qui visent à réguler les comportements des usagers de la rue.
Ce que nous essayons de mettre en avant, c’est que l’idée d’espace public avait été jusque-là cantonnée aux discussions théoriques en philosophie politique. À l’exception relative de l’identification au modèle grec de l’agora, elle n’était pas associée à une zone ou une étendue physique concrète, si ce n’est comme extension du concept de rue ou de scène : contrairement aux espaces intimes ou privés, ces dernières exposaient les gens aux initiatives et aux regards étrangers. Elle n’est devenue que tardivement un ingrédient rhétorique intégré à la présentation des plans urbanistiques et aux déclarations gouvernementales en matière de citoyenneté. Ce changement a largement dépassé la distinction première entre public et privé, qui se limiterait à identifier l’espace public à un espace de visibilité généralisée, où les personnes co-présentes forment une société pour ainsi dire « optique », dans la mesure où chacune de leurs actions est visible par les autres. Il s’agit d’un territoire d’exposition, au double sens d’exhibition et de risque. Or, le concept d’espace public aujourd’hui en usage va au-delà d’un espace où tout et tous sont visibles et vus.
En d’autres termes, le concept d’espace public dépasse la simple visée descriptive et véhicule une forte connotation politique. En tant que concept politique, l’espace public est supposé désigner une sphère de coexistence pacifique qui harmonise l’hétérogénéité de la société. Il est la preuve que ce qui nous permet de faire société est notre accord sur un ensemble de postulats à valeur programmatique permettant de dépasser les différences, sans pour autant oublier ou nier celles-ci, mais en les définissant à part, sur une autre scène que nous disons privée. Cet espace public s’identifie ainsi, en théorie, à un milieu de et pour le libre accord entre des êtres autonomes et émancipés qui y font l’expérience massive de la désaffiliation.
La sphère publique est alors, dans le langage politique, une construction grâce à laquelle chaque être humain est reconnu comme tel, comme un élément de la relation aux autres, auxquels il se lie par des pactes réflexifs et réactualisés en permanence. Il s’agit d’« un espace de rencontre entre personnes libres et égales qui raisonnent et argumentent dans un processus discursif ouvert orienté vers l’accord mutuel et l’autocompréhension normative[16] ». Cet espace est le socle institutionnel sur lequel se fonde la possibilité d’une rationalisation démocratique de la politique. Ce fort sentiment éidétique, qui renvoie à la nécessité de recourir à des significations fortes et à des compromis moraux, a rendu possible que la notion d’espace public devienne l’un des ingrédients conceptuels de base de l’idéologie citoyenniste, ce refuge doctrinal ou se nichent les derniers restes de gauche de la classe moyenne, et une bonne partie des restes du mouvement ouvrier[17].
Le citoyennisme se pose comme une sorte de démocratisme radical œuvrant à réaliser empiriquement le projet culturel de la modernité dans sa dimension politique. Selon lui, la démocratie serait à entendre non comme forme de gouvernement, mais plutôt comme manière de vivre et comme association éthique. C’est sur ce terrain que se développe le moralisme abstrait kantien ou l’éthique de l’État constitutionnel moderne postulée par Hegel. D’après ce qu’Habermas présente comme « paradigme républicain » – distingué du « paradigme libéral » –, le processus démocratique est la source de légitimité d’un système déterminé et déterminant de normes. De ce point de vue, la politique non seulement intervient mais forme et constitue la société, entendue comme l’association libre et égalitaire de sujets conscients de leur interdépendance, qui établissent entre eux des liens de reconnaissance mutuelle. De sorte que l’espace public en viendrait à constituer le domaine où se joue ce principe de solidarité communicationnelle, le milieu où sont rendus possibles et nécessaires un accord et une disposition discursive coproduits.
Le citoyennisme constitue de nos jours l’idéologie de prédilection de la social-démocratie qui, comme l’écrit Maria Toledano[18], est préoccupée depuis longtemps par la nécessité d’harmoniser l’espace public et le capitalisme pour atteindre la paix sociale et « la stabilité qui permet de préserver le modèle d’exploitation sans que les effets négatifs s’en ressentent sur l’agenda gouvernemental ». Mais le citoyennisme est aussi le dogme de référence pour des mouvements voulant la réforme éthique du capitalisme, qui visent à en atténuer les conséquences, au moyen d’une intensification des valeurs démocratiques abstraites et d’un renforcement des compétences étatiques qui la rendent possible. Ils ne considèrent pas l’exclusion et l’abus comme des facteurs structurels, mais comme de simples accidents ou contingences d’un système de domination qu’ils pensent perfectible sur un plan éthique. Cette idéologie, qui ne combat pas le capitalisme mais ses « excès » et son manque de scrupules, déclenche des mobilisations massives dont le but est de dénoncer des agissements spécifiques, publics ou privés, jugés comme injustes et surtout immoraux. Elle le fait en proposant des structures d’action et d’organisation labiles, qui s’appuient sur des sentiments collectifs davantage que sur des idées, en mettant particulièrement l’accent sur la dimension performative, et souvent purement « artistique » voire festive de l’action publique. Omettant toute référence à la classe sociale comme critère de classification, elle renvoie à un œkoumène diffus où les individus sont unis non par leurs intérêts, mais par leurs jugements moraux désapprobateurs ou approbateurs[19].
En tant qu’instrument idéologique, la notion d’espace public, espace démocratique par excellence dont l’acteur principal est cet être abstrait que nous appelons citoyen, correspondrait plutôt bien à certains concepts proposés par Marx en son temps. L’un des plus appropriés, emprunté à la Critique de la philosophie de l’État de Hegel[20], serait celui de médiation. Il désigne l’une des stratégies ou structures grâce auxquelles se produit une conciliation entre la société civile et l’État, comme si une chose et l’autre revenaient d’une certaine manière au même, et comme si un territoire s’était créé où les antagonismes sociaux auraient été annulés. Par le biais d’un tel mécanisme de légitimation symbolique, l’État peut sembler neutre aux yeux de secteurs sociaux aux intérêts et aux objectifs incompatibles (et pour le service desquels il existe et agit) comme assurément neutre, et incarner la possibilité de s’élever au-dessus des affrontements sociaux ou de les arbitrer, dans un espace de conciliation qui neutralise les luttes, car les éléments antagonistes y déclarent une sorte de trêve illimitée[21]. L’État obtient cet effet grâce à l’illusion qu’il est parvenu à créer selon laquelle les classes et les secteurs opposés dissolvent leurs contentieux, s’unissent, se fondent et se confondent en partageant des objectifs et des intérêts. Les stratégies de médiation hégéliennes servent en réalité, selon Marx, à camoufler toute relation d’exploitation, tout dispositif d’exclusion, ainsi que le rôle des gouvernements dans la dissimulation et le maintien de toutes sortes d’asymétries sociales. Il s’agit d’inculquer une hiérarchisation des valeurs et des significations, une capacité de contrôle sur la production et la distribution pour réussir à établir leur influence, c’est-à-dire pour faire respecter les intérêts d’une classe dominante et ce en se cachant derrière l’apparence de valeurs soi-disant universelles. L’illusion médiatrice de l’État (et avec elle les notions abstraites avec lesquelles il défend sa médiation) possédait – et possède toujours – un grand avantage : elle pouvait présenter et représenter la vie en société comme une question théorique en marge d’un monde réel dont on pouvait feindre d’oublier l’existence, comme si tout dépendait de l’application correcte de principes élémentaires d’ordre supérieur, capables en eux-mêmes – à la manière d’une nouvelle théologie de subordonner l’expérience réelle – si souvent faite de douleur, de rage et de souffrance d’êtres humains réels qui maintiennent entre eux des relations sociales réelles.
La notion d’espace public, en tant que matérialisation concrète de l’illusion citoyenniste, fonctionnerait comme un mécanisme dont la classe dominante use pour dissimuler les contradictions sur lesquelles elle repose, et en même temps pour obtenir l’approbation de la classe dominée en se prévalant d’un instrument – le système politique – capable de convaincre les dominés de sa neutralité. Elle consiste également à produire le mirage de la réalisation de l’unité souhaitée entre la société et l’État, dans la mesure où les représentants supposés de la première ont obtenu un consensus permettant de dépasser les différences de classe. Par le biais des mécanismes de médiation – en l’occurrence, l’idéologie citoyenniste et sa soi-disant matérialisation concrète dans l’espace public –, les classes dominantes auraient obtenu à travers les gouvernants à leur service obtiennent le consentement actif des gouvernés, et même la collaboration des secteurs sociaux maltraités, entravés par des formes de domination bien plus subtiles que celles reposant sur la simple coercition. Car ce qui garantit la pérennité et le développement de la domination classe n’est jamais la violence, « mais le consentement sous toutes ses formes des dominés à leur domination, consentement qui, jusqu’à un certain point, les fait coopérer à la reproduction de cette domination. […] Le consentement est la part du pouvoir que les dominés ajoutent à celle que les dominants exercent directement sur eux[22] ».
La domination d’une classe sur une autre ne peut évidemment se produire qu’au seul moyen de la violence et de la répression. Elle requiert le travail de ce qu’Althusser a présenté comme « les appareils idéologiques de l’État », qui éduquent – en réalité endoctrinent – les dominés à considérer comme « naturel » et inévitable le système de domination qui les assujettit en même temps qu’ils en assimilent, en les croyant leurs, les prémisses théoriques. De telle sorte que non seulement la domination domine, mais aussi dirige et oriente moralement la pensée et l’action sociales. Ces instruments idéologiques présentent de plus en plus une adaptabilité versatile, notamment parce qu’ils tendent à renoncer à se constituer en un système formel finalisé ; ils se donnent comme un ensemble d’orientations plutôt diffuses, de nature abstraite, malléable… facile, en un mot. Cela les rend ajustables à toute circonstance, où ils parviennent à avoir des effets prodigieusement clarifiants grâce à leur flou extrême. Ces nouvelles formes d’idéologie dominante ne se contentent pas de valoriser le consensus et la complicité des dominés, elles peuvent même exercer des formes de ruse qui neutralisent leurs ennemis en assimilant leurs arguments et initiatives, en les dépouillant de leur capacité critique, en les domestiquant, comme si leur faculté d’adaptation aux changements historiques ou environnementaux constants, ou leur faculté à les provoquer, dépendait d’une telle assimilation.
Nous serions donc, aujourd’hui, dans une situation où les idées de citoyenneté et – par extension – d’espace public seraient des exemples d’idées dominantes – dans le double sens d’idées des dominants et d’idées conçues pour dominer. Elles justifient et légitiment la gestion de ce qui deviendrait un consensus coercitif ou une contrainte adoptée d’un commun accord, jusqu’à un certain point, avec les sujets contraints eux-mêmes. Nous sommes à notre époque face à un élément fondamental de ce que Foucault appelait « modalité pastorale du pouvoir ». Il faisait référence à ce qui dans la pensée politique grecque – exemplaire du modèle de l’« agora » dont se réclame le discours sur l’espace public – était un pouvoir s’exerçant sur un troupeau d’individus différenciés et différenciables – « dispersés », disait Foucault – à la charge d’un chef qui devait – et il faut souligner qu’ainsi il accomplissait son devoir en faisant cela – « apaiser les hostilités au sein de la cité et […] faire prévaloir l’unité sur le conflit[23] ». Il s’agit alors de dissuader toute dissidence, toute capacité de contestation ou de résistance et – par extension – toute appropriation de la rue ou de la place perçue comme inappropriée. La violence peut être utilisée si nécessaire, mais il s’agit d’abord et surtout de disqualifier l’appropriation de l’espace ou de la discréditer, dans notre cas, non plus en lui attribuant une origine subversive, mais plus adroitement et subtilement une origine incivile, soit contraire aux principes abstraits du « bon vivre ensemble citoyen ».
Tout cela frappe de plein fouet la relation entre l’urbanisme et les citadins. Étant donné que le modelage culturel et morphologique de l’espace urbain est le fait d’élites professionnelles émanant pour la plupart des strates sociales hégémoniques, il est prévisible que ce qui se donne pour nom « urbanité » – le système de bonnes conduites civiques – en vienne à constituer la dimension comportementale adaptée à l’urbanisme. Ce dernier est entendu à son tour comme une pure et simple réquisition de la ville, une soumission de celle-ci aux intérêts territoriaux des minorités dominantes, aussi bien par le biais de la planification que de sa gestion politique.
L’espace public comme lieu
Cet espace public-catégorie politique doit être réalisé dans le deuxième espace public – physique cette fois – que sont ou sont censés représenter les espaces extérieurs de la vie sociale : la rue, le parc, la place… L’espace public matérialisé ne se réduit donc pas à une sophistication conceptuelle des scènes sur lesquelles de plus ou moins parfaits inconnus se rencontrent et gèrent une coexistence singulière non nécessairement dénuée de conflits. Son rôle est plus primordial encore, puisqu’on lui assigne la fonction stratégique de lieu attestant ou devant attester de la nature authentiquement égalitaire des systèmes « démocratiques », de lieu d’exercice des droits d’expression et de réunion permettant de contrôler les pouvoirs, de lieu à partir duquel ces pouvoirs peuvent être critiqués quand il s’agit des affaires qui concernent tout le monde.
Cet espace public comme catégorie politique qui organise la vie sociale et la configure politiquement nécessite de se voir confirmé comme lieu, espace, région, zone… où ses contenus abstraits abandonnent la superstructure qui était la leur et descendent sur terre, afin de, pour ainsi dire, « se faire chair parmi nous ». Il parvient ainsi à abandonner son caractère d’espace conceptuel et vise à être reconnu comme un espace ordonné, bien visible, même s’il faut pour cela éviter ou occulter les imprévus susceptibles de remettre en question la réussite effective de cette attente. Ainsi, une rue ou une place sont toujours quelque chose de plus que simplement une rue ou une place. Elles sont ou doivent être l’avant-scène sur laquelle cette idéologie citoyenniste prétend s’accomplir, le lieu où l’État réussit à nier momentanément la nature des relations sociales qu’il régit et sert, le lieu asymétrique qui met en scène le rêve impossible d’un consensus équitable et où il peut mener à bien sa fonction intégratrice et médiatrice.
En réalité, cet espace public est un milieu de ce que Lukács aurait appelé réification, puisqu’il se voit confier la responsabilité de devenir coûte que coûte ce qu’il est supposé être, il est en charge d’un devoir être. L’espace public est une de ces notions qui exigent de voir accomplie la réalité qu’elles évoquent et d’une certaine manière invoquent, une fiction nominale conçue pour inciter à penser et agir d’une certaine manière, et qui nécessite de se voir instituée comme réalité objective. Un certain aspect de l’idéologie dominante – en l’occurrence l’effacement des inégalités et leur dissolution dans des valeurs universelles supérieures – acquiert soudain, pour employer l’image que Lukács proposait, une « objectivité illusoire[24] ». En suivant cette voie et ce cadre, l’ordre économique autour duquel tourne la société reste sous-entendu ou éludé. L’espace public est en réalité l’extension matérielle d’une idéologie, au sens marxiste classique du terme, à savoir la dissimulation ou la fétichisation des relations sociales réelles. Il présente en outre la volonté commune à toutes les idéologies d’exister en tant qu’objet : « sa croyance est matérielle, en ce que ses idées sont ses actes matériels insérés dans des pratiques matérielles, réglées par des rituels matériels eux-mêmes définis par l’appareil idéologique matériel dont relèvent les idées de ce sujet[25] ».
L’objectif est donc de mener à bien une authentique transsubstantiation, dans le sens quasi liturgique et théologique du terme, de la même façon qu’on parle de transsubstantiation pour désigner l’hypostase sacrée de l’eucharistie. Par une série d’opérations rituelles et quelques incantations, une entité purement métaphysique devient soudain sensible, elle est là, on peut la toucher, la voir et, en l’occurrence, la parcourir et la traverser. Un espace théorique est devenu par magie un espace sensible. Ce qui était auparavant une rue est désormais une scène potentiellement inépuisable pour la communication et l’échange, une sphère accessible que tous peuvent s’approprier sans en réclamer la propriété, et où se produisent de constantes négociations entre les personnes coprésentes, qui jouent avec les différents degrés de rapprochement et de distanciation, sur la base de la liberté formelle et de l’égalité des droits. Enfin, le cadre physique du politique est entendu comme un terrain de rencontres interpersonnelles et une région soumise à des lois qui devraient garantir l’équité. En d’autres termes, le lieu de la médiation entre la société et l’État – ce qui revient à dire entre la sociabilité et la citoyenneté –, est organisé de manière à ce que prennent vie les principes démocratiques rendant possible la libre circulation des initiatives, des jugements et des idées.
Dans ce cadre, le conflit ne peut être perçu que comme une anomalie, ou, pire, comme une pathologie. Bien plus, c’est contre le conflit entre des intérêts irréconciliables que cette notion d’espace public, telle qu’elle est employée, se dresse. Dans le fond, on rencontre toujours la volonté de trouver un antidote moral pour que les classes et les secteurs ayant entre eux ou avec les pouvoirs des désaccords chroniques renoncent à leurs contentieux et abandonnent leur lutte, au moins pour ce qui est des moyens réellement susceptibles de modifier l’ordre socioéconomique. Nous avons vu cet effort pour soumettre les insolences sociales se répéter systématiquement, au nom de principes conciliateurs abstraits tels le civisme et l’urbanité, ces principes qui par exemple, dans le contexte européen du premier quart du XXe siècle, prétendaient asseoir les bases d’une cité idéale, embellie, cultivée harmonieuse, ordonnée. Un « amour civique » leur servirait à se rédimer et à surmonter les grandes convulsions sociales qui les agitaient depuis des décennies, embrumant et endormant les rêves démocratiques de la bourgeoisie. Cette dernière n’a jamais cessé de suivre le modèle que lui fournissaient Athènes ou les villes de la Renaissance, dont l’espace public moderne voulait être la reconstruction, ainsi que l’a montré Hannah Arendt dans sa défense de l’agora grec. De tels principes de conciliation et de rencontre – synthèse des pensées politiques d’Aristote et de Kant – exigent d’être confirmés dans la réalité pleine et entière, là-dehors, et la citoyenneté comme catégorie devrait se transformer en réalité et l’urbain en urbanité. Cette urbanité s’identifie à la courtoisie, ou l’art de vivre à la cour, puisque la conduite adéquate lors de la rencontre entre des êtres distincts et inégaux doit être régulée par des normes de comportement concevant la vie dans des lieux partagés comme un gigantesque bal de cour où les personnes soumettent leurs relations à la maîtrise de l’étiquette, à un « savoir être » qui les égalise.
Dans la rue, devenue espace public, la figure jusqu’alors entéléchique du citoyen, qui condense les principes d’égalité et d’universalité démocratiques, prend dorénavant les traits de l’usager. C’est lui qui met en pratique les droits qui rendent ou devraient rendre possible l’équilibre entre un ordre social inégalitaire et injuste et un ordre politique équitable en théorie[26].
L’usager devient ainsi dépositaire et exécuteur de droits qui s’enracinent dans la conception même de civilité démocratique. C’est lui qui bénéficie d’un minimum d’égalité face aux aléas de la vie, dont l’accès aux prestations sociales et culturelles dont il a besoin est garanti. Cet individu est piéton, automobiliste, passager… un personnage qui réclame le droit à l’anonymat et à la discrétion et qui n’a pour identité que celle d’une masse corporelle à visage humain, d’un individu souverain dont on suppose et dont on reconnaît la compétence d’agir et de communiquer rationnellement, et qui est soumis à des lois valables pour tous.
Chaque passant est ainsi en quelque sorte enlevé imaginairement et conduit dans une espèce de non-lieu ou de nirvana d’où les différences de statut et de classe ont été bannies. Cet espace limbique, auquel on fait jouer un rôle structurant pour l’ordre politique en vigueur, en vient à supposer quelque chose de l’ordre de l’annulation ou de l’anéantissement de la structure ; ce qui importe n’est pas l’identité ou la nature de chacun, mais ce que chacun fait et ce qui lui arrive. Cette contradiction apparente ne l’est pas si l’on comprend que ces limbes mettent en scène une situation d’a-structuration du reste purement illusoire, une sorte de « communitas[27] ». Par elle, une société, profondément hiérarchisée et stratifiée fait l’expérience d’une fraternité imaginaire universelle qui donne l’opportunité au présupposé égalitaire des systèmes démocratiques – dont tout le monde a entendu parler, mais que personne n’a jamais vu – d’exister telle une réalité palpable. C’est en cela que consiste l’effet optique démocratique par excellence : celui d’un milieu où les inégalités se proclament abolies par magie.
Il va sans dire que l’expérience réelle de ce qui arrive dehors, dans ce que l’on nomme « espace public », fournit des preuves sans nombre du contraire. Les lieux de rencontre ne permettent pas toujours de se soustraire à la place que chaque concurrent occupe dans un organigramme social qui distribue et institutionnalise les inégalités de classe, d’âge, de genre, d’ethnie, de « race ». Certains types de personnes, en théorie bénéficiaires du statut de citoyenneté à part entière, sont publiquement dépouillés, en totalité ou en partie, de l’égalité, en conséquence de toutes sortes de stigmatisations et négations. D’autres – les non-nationaux et donc non-citoyens, immigrés par millions – sont en proie à un harcèlement continuel et à l’examen constant de leur identité. Ce qui était tenu pour un ordre social public basé sur l’adéquation entre des comportements opérationnels pertinents, un ordre transactionnel et interactionnel basé sur la communication généralisée, se voit encore et toujours démasqué : il s’agit d’une arène de et pour le marquage de certains individus ou collectifs, que l’identité réelle ou attribuée place dans un état d’exception dont l’espace public ne les libère en rien. Bien au contraire, il accentue dans beaucoup de cas leur vulnérabilité. C’est sur cette vérité que le discours citoyenniste et celui de l’espace public nous invitent à fermer les yeux.
Le public contre la racaille
Rien de nouveau, quoi qu’il en soit. Nous nous trouvons face à la réactualisation de problématiques qui sont à l’origine même de l’histoire des sciences sociales, partenaires obligées dans la formalisation théorique de la réconciliation entre dominateurs et dominés et dans la pathologisation de tout ce qui n’est pas production de consensus social. C’est évidemment le cas de toute la sociologie française qui naît, en soutien aux valeurs républicaines, à la fin du XIXe siècle autour de la figure de Durkheim, théoricien essentiel de la solidarité sociale comme troisième voie entre socialisme marxiste et libéralisme[28], même si tous ses développements ne sont pas allés dans ce sens, et que le courant a connu des variantes de très grande radicalité politique. C’est également le cas du pragmatisme nord-américain. De la même manière qu’en Europe sous la plume de Le Bon ou Tarde, on trouve aux États-Unis – chez Dewey – la volonté de mettre en circulation le concept de public pour encoder sous l’idée de concert pacifique une agitation sociale menée par les masses urbaines, souvent présentées comme le « troupeau » ou la « populace ». D’où l’École de Chicago et sa vocation pour une bonne part chrétienne-réformiste de rédemption morale de l’anomie urbaine. Il suffit de penser à la façon dont Robert Ezra Park reconnaissait seulement deux modèles d’ordre social. Le modèle « culturel », basé sur un ordre moral, guidé par des principes, des valeurs et des significations partagées, et cet autre ordre que le même Park – très proche du darwinisme social – définissait comme « biotique » ou « écologique » pour désigner les dynamiques compétitives en faveur de ressources rares, les ajustements réciproques de nature polémique, l’adaptation traumatique à des contextes sociaux peu ou mal structurés, les phénomènes d’expansion et d’insertion dans le territoire[29]. La réforme devait consister à passer de cet ordre socio-biotique dépourvu de cœur, qui engendrait le conflit et s’en nourrissait, à cet autre ordre social moral supérieur, basé sur l’accommodation réciproque et l’assimilation.
Souvenons-nous que « le public » est né dans une large mesure comme domaine voué à la dilution des grandes luttes de religion qui caractérisèrent le XVIIe siècle, comme milieu voué à la réconciliation et au consensus entre des secteurs sociaux aux identités et intérêts opposés[30]. Entre autres définitions, on peut donner à la notion d’espace public celle de l’espace d’un personnage collectif que nous avons l’habitude de connaitre comme « le public ». Il est à nouveau pertinent de nous référer à la manière dont Jürgen Habermas[31] a fait des recherches sur l’histoire de cette notion de public, servant à désigner en l’occurrence un type de regroupement social constitué d’individus prétendument libres et égaux qui évaluent ce qui s’offre à leur jugement – ce qui est rendu public à partir de critères rationnels de valeur, de bonté et de qualité.
Ici, il serait important de reconnaitre la dette contractée envers Gabriel Tarde[32], pour qui le public est responsable d’un type d’action conjointe qui renonce à l’espace matériel et se forme à partir d’un lien purement spirituel entre individus dispersés, un ensemble humain dont les opinions constituent le facteur de cohésion, celles-ci pouvant se passer de rencontres physiques. On ne peut comprendre un tel type d’agrégat social qu’en opposition à celui de la foule, cet autre personnage collectif, qui se concrétise quant à lui dans l’espace comme fusion des corps agissant de concert. Les foules se sont révélées tout au long du XIXe siècle les actrices principales de toutes sortes de révolutions et d’émeutes. La première psychologie des masses – Izoulet, Sighelle, Rossi, Espinas, Le Bon, et plus tard Freud lui-même – leur a attribué une condition infantile, criminelle, bestiale, primitive, hystérique – autrement dit féminine –, voire diabolique, en raison de leur tendance à devenir populace. C’est contre ce type d’agrégat humain et sa prééminence dans le monde contemporain que mettra en garde Ortega y Gasset dans La Révolte des masses[33]. C’est pour contrebalancer cette tendance psychotique attribuée aux foules qu’on a vu se développer un autre type de destinataire souhaité pour la gestion et le contrôle politiques : l’opinion publique, c’est-à-dire l’opinion du public comme ensemble discipliné et responsable d’individualités, la catégorie de base pour la gestion étatique des foules.
Dans la même voie, c’est à John Dewey[34] que revient l’une des principales formalisations de cette catégorie de public, servant à désigner une association caractéristique des sociétés démocratiques par opposition à d’autres formes de communauté humaine. Un de ses traits principaux serait celui de la réflexivité, dans le sens où ses membres seraient toujours conscients de leur rôle actif et responsable au moment de prendre en compte les conséquences de l’action individuelle et de celle d’autrui, au moment où toute conviction, toute affirmation peut être mise à l’épreuve par le débat et la délibération. Mais il convient d’observer que cette philosophie était conçue en grande partie précisément pour asseoir les bases doctrinales d’une authentique démocratisation des foules urbaines, auxquelles le processus de constitution de la civilisation industrielle accordait depuis des décennies un rôle central, si souvent inquiétant pour le grand projet bourgeois de pacification généralisée des relations sociales.
Ce contraste – dialectique et aux frontières réversibles – entre public et foule ou masse s’est maintenu. Pensons à la concrétisation de l’idée abstraite, déjà mentionnée, de public comme groupe de personnes partageant les mêmes goûts ou se rendant de préférence dans un endroit déterminé, c’est-à-dire comme actualisation du concept classique d’auditoire. On se réfère dans ce cas à un type d’association de spectateurs – c’est-à-dire d’individus qui assistent à un spectacle public – dont on attend une conduite responsable et une capacité de discernement pour évaluer ce qui est soumis à sa considération. Il va sans dire que ceux qui sont convoqués et constitués en public ne renoncent pas à la particularité de leurs critères respectifs, puisque aucun d’entre eux ne perdra jamais de vue ce qui le rend unique et irremplaçable. Ce qui s’opposerait à cette image désirée d’un public spectateur rationnel et intelligent serait un regroupement de spectateurs qui auraient renoncé à maintenir entre eux la distance morale et physique qui les distinguaient les uns des autres et accepteraient de se voir subsumés dans une masse acritique, confuse et désordonnée, où chacun aurait succombé à l’état d’irresponsabilité, de stupéfaction et d’abrutissement qui avait été attribué à la foule énervée, l’entité même contre laquelle la notion de public avait été mise en place. Les spectateurs rassemblés dégénèrent alors en voyous effrénés, victimes d’une aliénation subite qui les a aveuglés, les rend inaptes au jugement rationnel et les prépare à ce que la réponse aux stimuli reçus débouche à tout sur des excès et de la violence.
Tel était alors l’objectif. Il se traduit aujourd’hui par de nouvelles formules, qui reviennent au même : parvenir à ce que les masses irrationnelles deviennent un public rationnel et que les ouvriers et les membres d’autres secteurs sociaux potentiellement conflictuels ou « dangereux » se conçoivent comme des citoyens, et ce, non pas dans le sens que le terme avait acquis par exemple sous la Commune de Paris en 1871, mais dans le sens de rouages intégrés à une sphère de fraternité interclassiste. Tel était l’objectif, tel est-il encore. Il imprègne toujours plus les convictions et les pratiques de ceux qu’on espère convertir en croyants, puisque, en fin de compte, c’est bien un credo qu’il s’agit de faire adopter. Un dispositif pédagogique est déployé dans ce but, concevant l’ensemble de la population, et pas seulement les plus jeunes, comme des apprentis permanents de ces valeurs abstraites de citoyenneté et de civilité. Cela se traduit par toutes sortes d’initiatives législatives visant à inclure dans les programmes scolaires des cours de « civisme » ou d’« éducation à la citoyenneté », par l’édition de manuels sur les bonnes conduites citoyennes, par de récurrentes campagnes institutionnelles de promotion du vivre ensemble, etc. Il s’agit de diffuser ce que Sartre aurait appelé le squelette abstrait de l’universalité grâce d’où les classes dominantes tirent leurs principales sources de légitimité et qui s’incarne dans la vocation fortement pédagogique sans cesse revendiquée par l’idéologie citoyenniste, dont l’espace public serait à la fois la salle de cours et le laboratoire.
Tel est le sens des initiatives institutionnelles pour lesquelles tous acceptent ce territoire neutre vidé de spécificités en matière de pouvoir et de domination. Elles louent des valeurs grandiloquentes et en même temps irréfutables – paix, tolérance, durabilité, coexistence des cultures. De leur essor dépend le fait que cet espace public mystique de la démocratie formelle se matérialise en un endroit, à un moment. À son tour, cette didactique – et les ritualisations qui lui correspondent, sous forme d’actions et de fêtes destinées à sacraliser la rue, l’exorciser de toute présence conflictuelle et la transformer « espace public » – soutient l’étape éthique et esthétique qui justifie et légitime les futures législations et normes présentées comme « civiques ». Approuvées et déjà en vigueur dans de nombreuses villes, celles-ci montrent jusqu’où conduit cet effort pour que l’espace public soit avant tout « ce qu’il devrait être ». Ce type de législations est bien illustré par celle de Barcelone, présentée à l’automne 2005, sous le titre de Ensemble de mesures pour encourager et garantir le vivre ensemble citoyen dans l’espace public de Barcelone. Son objectif : « Préserver l’espace public comme lieu de vivre ensemble et de civisme. »
On a beau les présenter au nom du « vivre ensemble », il s’agit en réalité de mesures qui s’inscrivent dans le contexte global de « tolérance zéro » – Giuliani, Sarkozy –, et qui se traduisent par la mise en place d’un état d’exception voire d’un couvre-feu pour les secteurs considérés les plus inconvenants de la société. Il s’agit de la génération d’un véritable tournant comminatoire, d’un exercice de répression préventive contre des tranches paupérisées de la population : mendiants, prostituées, immigrés. Ces réglementations servent dans la pratique à harceler des formes de dissidence politique ou culturelle qui se risquent à contredire ou passer outre le cours normal d’une vie publique décrétée aimable et exempte de problèmes.
Le civisme et la citoyenneté assignent à la vigilance et aux actions policières la tâche d’obtenir ce que leurs invocations rituelles – campagnes publicitaires, éducation aux valeurs, fêtes « civiques » – ne parviennent pas à faire : discipliner cet espace extérieur urbain, dont non seulement on n’a pu exclure les manifestations de désaffection ou d’ingouvernabilité, mais dans lequel on n’est même pas parvenu à étouffer le scandale d’une dualisation sociale croissante. La pauvreté, la marginalité, le mécontentement, bien souvent la rage, continuent à faire partie du public, mais entendu maintenant comme ce qui est là, à la vue de tous, qui se refuse à respecter les consignes le cantonnant à la clandestinité. L’idéalisme de l’espace public – qui est celui de l’intérêt universel capitaliste – ne renonce pas face au démenti d’une réalité faite de contradictions et d’échecs. À son tour, celle-ci refuse de reculer devant le vade retro qu’agitent les valeurs morales d’une classe moyenne bien-pensante et vertueuse, dont le rêve doré d’un apaisement général du lien social s’avère encore et toujours avorté.
[1] JACOBS, Jane, Déclin et survie des grandes villes américaines, trad. C. PARIN-SENEMAUD, Liège, P. Mardaga, 1991 [1961], p. 41.
[2] AUGOYARD, Jean-François, Pas à pas, Seuil, Paris, 1979.
[3] LYNCH, Kevin, L’Image de la cité, trad. M.-F. et J.-L. Vénard, Paris, Dunod, 1971 [1960].
[4] RAPOPORT, Amos, Human Aspects of Urban Form, Oxford-New YorkParis, Pergamon Press, 1977.
[5] BORJA, Jordi, Estado y Ciudad, Barcelone, PPU, 1988.
[6] LEFEBVRE, Henri, Le Droit à la ville, Paris, Anthropos, 1972.
[7] LEDRUT, Raymond, Les Images de la ville, Paris, Anthropos, 1973.
[8] WHYTE, William H., City. Rediscovering the Center, New York, bieday, 1988, p. 51, 163, 211, 251.
[9] WHYTE, William H., The Social Life of Small Urban Places, New York, Project for Public Spaces, 2001 [1980] ; JOSEPH, Isaac, Le Passant considérable. Essai sur la dispersion de l’espace public, Paris, Librairie des Méridiens, 1984 ; DELGADO, Manuel, El animal público. Hacia una antropologia de los espacios urbanos, Barcelone, Anagrama, 1999 ; Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropologia de las calles, Barcelone, Anagrama, 2007.
[10] GOFFMAN, Erving, Comment se comporter dans les lieux publics : notes sur l’organisation sociale des comportements, trad. D. Cefai, Paris, Économica, 2013 [1963].
[11] LOFLAND, Lyn H., A World of Strangers. Order and Action in Urban Public Space, San Francisco, Université de Californie, 1985, p. 19 ; LOFLAND, John et LOFLAND, Lyn H., Analyzing of Social Settings, Wadworth, Belmont, 1984.
[12] ARENDT, Hannah, L’Humaine Condition, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2012 [1958].
[13] KOSELLECK, Reinhardt, Le Règne de la critique, trad. H. Hildenbrand, paris, Éditions de Minuit, 1979 [1959].
[14] HABERMAS, Jürgen, La technique et la science comme « idéologie », trad. J.-R. Ladmiral, Paris, Gallimard, 1973 [1968].
[15] SENNETT, Richard, The Fall of Public Man, Londres, Penguin, 2002 (1974).
[16] SAHUI, Alejandro, Razón y espacio público. Arendt, Habermas y Rawls, México DF, Ediciones Coyoacán, 2000, p. 20.
[17] Voir le pamphlet L’Impasse citoyenniste, https://infokiosques.net
[18] TOLEDANO, Maria, « Espacio público y dominio de mercado » Público, 23 octobre 2007.
[19] On trouvera des références pour connaître les postulats citoyennistes et le rôle qu’y joue le concept d’espace public dans BORJA, Jordi, Estado y Ciudad, op. cit. ; INNERARITY, Daniel, El Nuevo espacio público, Madrid, Espasa-Calpe, 2007 ; SUBIRATS, Marina, Civisme per la convivencia, Barcelone, Icaria, 2006, avec des textes de Salvador Cardús, Joan Subirats, Josep Maria Terricabras, Marina Subirats, Manuel Castells, entre autres.
[20] MARX, Karl, Œuvres philosophiques IV. Critique de la philosophie de l’État de Hegel, trad. J. Molitor, Paris, A. Costes, 1935 [1844].
[21] BARTRA, Roger, El poder despótico burgués. Las raices campesinas de las estructuras politicas de mediación, Barcelone, Peninsula, 1977.
[22] GODELIER, Maurice, L’Idéel et le Matériel, Paris, Fayard, 1984, p. 24.
[23] FOUCAULT, Michel, « Omnes et singulatim : vers une critique de la raison politique », Dits et écrits IV, Paris, Gallimard, 1994 [1981], p. 138.
[24] LUKÁCS, Georg, Histoire et conscience de classe, trad. K. Axelos et J. Bois, Paris, Éditions de Minuit, 1960 [1923], p. 110.
[25] ALTHUSSER, Louis, http://classiques.uqac.ca/contemporains/althusser_louis/ideologie_et_AIE/ideologie_et_AIE.html [1970].
[26] CHAUVIÈRE, Michel et Jacques T. GODBOUT (dir.), Les Usagers entre marché et citoyenneté, Paris, L’Harmattan, 1995.
[27] Pour reprendre le terme que proposait Victor Turner dans Le Phénomène rituel, trad. G. Guillet, Paris, Presses universitaires de France, 1990 [1969].
[28] ALVAREZ-URfA, Fernando, et VARELA, Julia, Sociología, capitalismo y democracia, Madrid, Morata, 2004, p. 207-238.
[29] PARK, Robert Ezra, « La Ville. Propositions de recherche sur le comportement humain en milieu urbain », dans GRAFMEYER, Yves et JOSEPH, Isaac, (dir.), L’École de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Paris, Éditions Aubier, 1984 [1925].
[30] Comme l’établit dans sa proposition de généalogie Reinhardt KOSELLECK, Le Règne de la critique, op.cit.
[31] HABERMAS, Jürgen, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, trad. M. B. de nay, Paris, Payot, 1978 [1961].
[32] TARDE, Gabriel, L’Opinion et la Foule, Paris, Éditions du Sandre. 2006 [1901].
[33] ORTEGA Y GASSET, José, La Révolte des masses, trad. L. Parrot, Paris, Stock, 1937 [1931].
[34] DEWEY, John, Le Public et ses problèmes, trad. J. Zask, Paris, Gallimard, 2010 [1927].
***
Titre original : El espacio público como ideología, 2011.
Traduit de l’espagnol par Chloé Brendlé pour la première publication en français, CMDE, Toulouse, 2016.
Le livre paru au CMDE comprend aussi trois autres chapitres :
– Les pièges de la négociation
– Morphologie urbaine et conflit social
– Citoyen, mythoyen